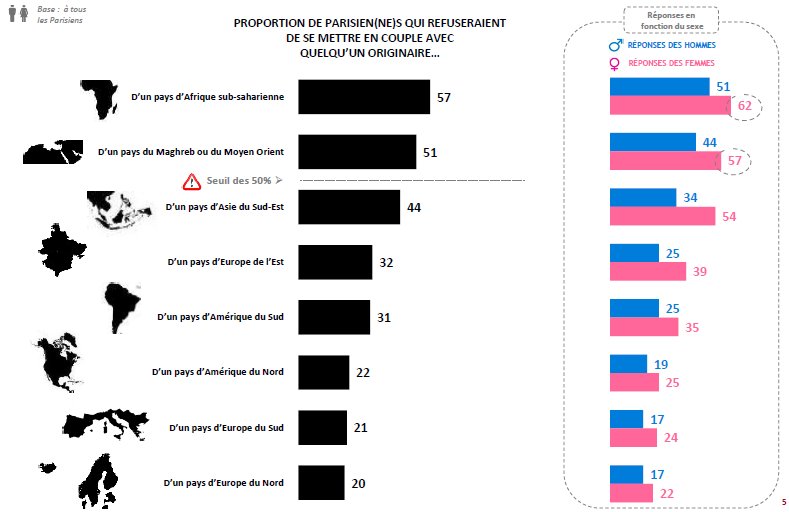Bonjour à tous ! Cette semaine je vous propose le premier épisode d’une série d’articles consacrés à la culture populaire sous l’Ancien Régime. Ce sera l’occasion d’évoquer les fêtes, les coutumes, les pratiques populaires, la violence aussi (alors omniprésente) et le rôle du pouvoir (monarchie et Église) dans le contrôle et la transformation de cette culture des masses. Ce premier article est consacré à la vision du monde dans les zones rurales jusqu’au XVIIe.

Bruegel l’Ancien, Les moissons (1565).
Le monde rural européen de la fin du Moyen Âge et des premiers siècles de l’époque moderne est fondamentalement un monde d’insécurité et de peurs : pestes, famines et disettes, guerres, maladies, mortalité infantile importante, (…) hantent les esprits. Les hommes ne disposent pas alors de véritables connaissances scientifiques sur le fonctionnement du monde.
On ne connaît pas les microbes et les mécanismes physiologiques ; ainsi toute maladie ou mort n’est considérée que comme la conséquence de l’infiltration de forces néfastes dans le corps. Face à ces peurs réelles ou imaginaires, les hommes ont élaboré une vision du monde cohérente composée de superstitions et d’histoires pouvant nous paraître étranges mais qui étaient à l’époque mentalement sécurisantes.
Note : deux sources sont utilisées pour les superstitions. Les superstitions tirées du Livre des Quenouilles (ou Évangile des femmes, fin du XVe siècle, auteurs anonymes) sont marquées par *, celles tirées du Traité des superstitions (1679) de Jean-Baptiste Thiers, curé du diocèse de Chartres, sont signalées par **.
I. Un corps magique
Cette vision est d’abord marquée par l’idée de totalité (vision holiste), rien n’étant indépendant. Le corps n’est pas perçu comme un objet individuel inséré dans son environnement mais comme une partie d’un tout. Les hommes doivent faire attention aux moindres de leurs gestes sous peine de déclencher des calamités. Cette attention continuelle se manifeste par des tabous et des rites visant à éloigner le malheur et provoquer le bonheur.
Le corps est lui-même dangereux, étant en contact avec l’extérieur par le biais notamment de la bouche, de l’anus et du sexe, un grand nombre de superstitions se greffant sur ces trois parties anatomiques. Ainsi, uriner contre un monastère ou un cimetière peut conduire à l’apoplexie ou à la gravelle (*), ne pas pisser contre un mur où un lépreux a pissé permet d’éviter de devenir soi-même lépreux (*). Un mal du sein peut être guéri par le mari en faisant trois cercles autour de la partie douloureuse avec « l’instrument viril » (*). Avant le mariage, afin de se protéger de divers maléfices, le futur marié peut uriner trois fois dans l’anneau destiné à la mariée (**). Pour guérir d’une maladie, on peut boire dans un sceau d’eau après qu’un cheval y ait bu (**) ou boire de l’eau bénite les veilles de Pâques ou de la Pentecôte (**).
Il ne faut pas s’étonner de pratiques qui paraissent aujourd’hui sales ou honteuses : au XVe et XVIe siècles, on pisse et défèque en public (y compris les nobles), ce qui est alors nommé « la matière joyeuse » (la merde) n’est pas considérée comme taboue, on n’hésite pas à exhiber ses parties intimes et les mœurs sexuelles sont très libres. Cet état de fait changera à partir du XVIIe siècle, plus rapidement en milieu urbain et dans les couches supérieures.
● Autour de la grossesse et de l’accouchement

Francesco Furini, L’accouchement et la mort de Rachel (XVIIe).
L’un des moments de la vie les plus dangereux est celui de la grossesse et de l’accouchement, attendu avec impatience mais aussi redouté et objet de toutes les angoisses. L’accouchement peut être fatal à l’enfant comme à la femme. D’où toute une série de rites visant à éloigner le malheur ou de signes permettant de connaître à l’avance le résultat.
Le père du futur enfant doit éviter de le concevoir avec des pieds sales et puants, sinon le fils aura mauvaise haleine et si c’est une fille elle « l’aura puante par derrière » (*). Une femme en état de grossesse doit éviter de se trouver dans la pièce où quelqu’un agonise : l’enfant qu’elle porte risquerait de naître marqué d’une tache blanche au-dessus du nez qui signifie que cet enfant ne vivra pas longtemps (**). En Provence, les femmes mettent couramment des roses de Jéricho dans l’eau : si elles s’ouvrent, l’accouchement sera heureux ; si au contraire elles ne s’ouvrent pas, l’accouchement sera malheureux (**). Dans le diocèse de Chartres, les femmes peuvent s’assurer un accouchement heureux en allant prier devant le Saint prépuce que possèdent les moines de l’abbaye de Coulombs (**). Des rites accompagnent aussi le moment de l’accouchement : une femme sera plus rapidement libérée par exemple si elle chausse les bas et souliers de son mari ou si quelqu’un monte sur le toit de la maison « dire certaines paroles » (**). Et si par malheur la femme accouche d’un enfant mort-né, il faut faire sortir le cadavre par la fenêtre et non par la porte, sinon la mère passant plus tard par cette porte risquerait de ne mettre au monde par la suite que des enfants morts-nés (**).
II. Signes de bonheur et de malheur
La nature est perçue par l’homme des temps modernes comme ambivalente, composée de forces nuisibles (diable, démons, mauvais esprits) mais aussi de forces positives (bons esprits, actions des saints,…). L’homme moderne, s’il croit au paradis, à l’enfer et au purgatoire, considère son environnement comme peuplé d’esprits et d’entités diverses. Les morts sont en interaction constante avec les vivants, partageant leurs bonheurs et malheurs, et pouvant les aider ou, au contraire, leur nuire. Toutes ces entités invisibles envoient aux vivants des signes avertisseurs de danger ou au contraire des signes de bonheur.
Ainsi, des cigognes faisant leur nid au-dessus d’une maison assurent à ses habitants richesse et longue vie (*). Un chien ou un loup qui hurle annonce des malheurs, mais c’est l’inverse pour un cheval (*). Le chat est ambivalent : s’il est considéré comme un animal diabolique, il suscite un grand intérêt. Il faut lui couper le bout de la queue une fois qu’il a quatre ans, car il penserait alors « nuyt et jour comment il porra son maistre estrangler » (*). Le trèfle à quatre feuilles porte bonheur, mais si un homme marche dessus pieds nus il attrapera la fièvre blanche, si c’est une femme elle perdra la fidélité de son époux (*). Lorsque l’on va au domicile de l’éventuelle fiancée pour faire la demande de mariage, rencontrer en chemin une vierge, une femme grosse, un moine, un lièvre, un prêtre, un chien, un chat, un borgne, un boiteux, un aveugle, un serpent, un lézard, un cerf, un chevreuil ou un sanglier est mauvais signe (**). Dans la vie quotidienne, croiser le matin « une femme ou une fille débauchée », un loup, un crapaud ou une cigale est un signe de bon augure (**).
III. Un Christianisme paganisé : l’exemple des pèlerinages thérapeutiques en Bretagne

Bruegel le Jeune, La procession nuptiale (1627).
Les ruraux de l’époque moderne sont des chrétiens sincères qui croient de bonne foi aux grands dogmes chrétiens. Néanmoins, ils mélangent dans leurs croyances chrétiennes des éléments de paganisme. Face aux maladies, le recours aux saints guérisseurs est une pratique populaire. Si pour l’Eglise les saints n’ont qu’un rôle d’intercession auprès de Dieu, les ruraux voient en eux des puissances surnaturelles autonomes capables d’intervenir sans en référer à Dieu. Ici sera pris l’exemple de la Bretagne.
La Bretagne est dotée de nombreux saints guérisseurs, certains n’ayant qu’une influence géographique très limitée comme saint Lubin (saint généraliste), saint Mamert (maux de ventre), saint Méen (folie) ou saint Livertin (maux de tête) à Notre-Dame-du-Haut en Montcontour (Côtes-du-Nord actuelles). Un certain nombre de maux sont ainsi désignés par le nom d’un saint : la méningite est le mal Saint-Claude, les hémorroïdes ou la gale, le mal Saint-Fiacre ; l’épilepsie le mal Saint-Jean.
Les pèlerinages peuvent être collectifs ou individuels, une personne pouvant faire le voyage seule en raison d’une urgente nécessité. Une pratique révélatrice d’une pensée encore para-chrétienne chez les pèlerins est la vengeance à l’encontre des saints si le vœu des voyageurs n’est pas exaucé. Le saint et le pèlerin sont en effet liés par un contrat implicite : si le pèlerin a scrupuleusement accompli les rites exigés, le saint se doit de répondre à ses prières, sinon il y a en quelque sorte « rupture du contrat ». Ainsi, les clercs observent qu’en Basse-Bretagne, on n’hésite pas à fouetter la statue du saint ou la plonger dans l’eau pour punir celui qui ne répond pas aux prières ! Cette pratique de « vengeance » s’observe ailleurs en France : les vignerons de l’Allier et de la Saône-et-Loire, au XVIIIe siècle, entretiennent semblables pratiques envers saint Georges, saint Marc et saint Eutrope si les récoltes ne sont pas bonnes !
● Les guérisons pour le sanctuaire Sainte-Anne d’Auray
Le pèlerinage de d’Auray est une « création » récente puisque ce n’est qu’en 1625 qu’un laboureur nommé Nicolazic, âgé d’une trentaine d’années, découvrit une statue de sainte Anne suite à des apparitions de cette sainte. Les premiers fidèles qui se pressent sur le lieu et les premiers « miracles » entraînent un afflux de visiteurs. Des registres ont été tenus de 1625 à 1684 par les carmes.
(entre parenthèses est indiquée la moyenne annuelle)
1625-1630 : 136 (23)
1631-1640 : 279 (28)
1641-1650 : 440 (44)
1651-1660 : 140 (16)
1661-1670 : 192 (19)
1671-1680 : 62 (6)
1681-1684 : 43 (11)
On observe un recul très net à partir de 1650. Quelques éléments statistiques : sur 1267 déclarations de miracles, 98 seulement concernent des non-Bretons ; deux tiers des guérisons concernent des ruraux ; 59 % des « miraculés » sont des hommes ou garçons ; 3 % appartiennent au clergé, 9 % à la noblesse, 30 % à la bourgeoisie (remarquez la sur-représentation des élites par rapport aux gens du peuple).
Sur les 557 miracles survenus de 1634 à 1646, 323 concernent des maladies, 25 des accouchements difficiles, 24 des brûlures ou des incendies, 91 concernent l’eau (noyades et naufrages). Sur les 323 malades, 54 sont paralytiques, 24 aveugles, 23 épileptiques et névropathes, 19 muets, 15 dysentériques, 14 varioleux, 9 pestiférés, 40 atteints de « fièvres », 30 de « maladies ».
Sources :
MUCHEMBLED, Robert. Culture populaire et culture des élites dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle). Flammarion, 1991.
LEBRUN, François. Croyances et cultures dans la France d’Ancien Régime. Seuil, 2001.