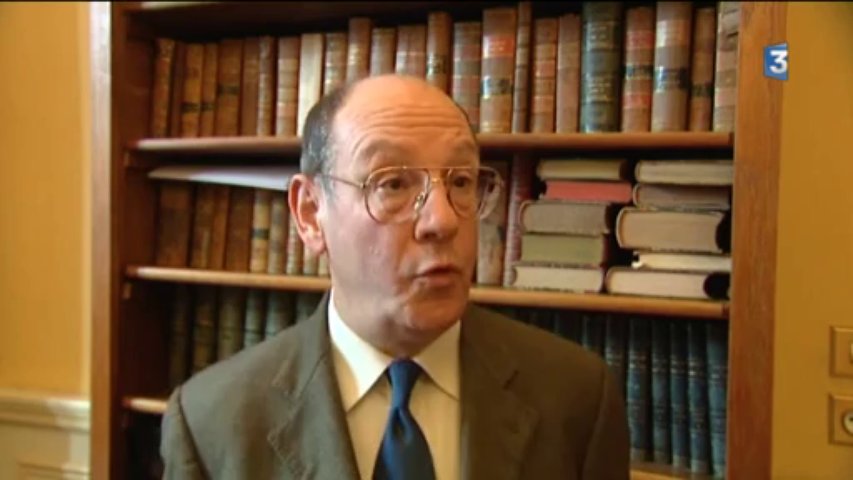Conçu naguère comme un laboratoire social, le quartier a été classé zone de sécurité prioritaire après le meurtre de Kevin et de Sofiane. Reportage.
Notre voiture roule au pas dans les allées de la cité de L’Arlequin. Faiblement éclairés par la lueur des lampadaires, les immeubles se fondent dans la nuit. Mais, partout, des guetteurs scrutent le moindre mouvement.
À peine sortis photographier les lieux, nous voilà pris à partie par un groupe de jeunes menaçants : « Dégage de là ou je t’arrache la tête, bâtard ! » Des canettes fusent, des cris et sifflets retentissent. En deux minutes, surgis des buissons et cages d’escalier, ils sont bientôt une quinzaine à s’avancer sur le parking.
Inférieurs en nombre, armés seulement de tonfas et d’une bombe lacrymogène, les policiers municipaux chargés de notre sécurité optent pour une prudente retraite : « Il est temps de partir. » Nous reculons jusqu’au véhicule de service qui repart aussitôt sous les hurlements des voyous. Il est minuit moins cinq au coeur du quartier de la Villeneuve, à Grenoble.
Le 28 septembre, l’assassinat des jeunes Kevin et Sofiane par des individus armés de couteaux, de battes de base-ball et de marteaux, a choqué l’opinion. Mais ce drame n’est que le symptôme d’un mal plus profond : bien que choyée par la Mairie et placée sous perfusion sociale constante, La Villeneuve illustre le calamiteux échec de la politique de la Ville depuis les émeutes de 2010.
L’histoire avait pourtant bien commencé. Nous sommes au début des années 1970, Mai 68 n’est pas loin. Les urbanistes rêvent de bâtir une “cité modèle” : une utopie. Ce sera La Villeneuve, à cheval sur Grenoble et Échirolles, vieux fief de la gauche.
En 1972, ce “laboratoire social” surgit de terre sous forme d’un vaste cercle d’immeubles de quatre à dix-sept étages, organisés autour d’immenses espaces verts.
Les appartements sont spacieux, les parties communes décloisonnées pour faciliter les contacts. Il y a une halle pour le marché, un gymnase, une patinoire, une salle de spectacle et même un lac artificiel pour se baigner. Le centre de santé pratique la “médecine lente” et les écoles expérimentent les “pédagogies alternatives”.
D’autres bâtiments s’agglomèrent au complexe, comme ceux du Village olympique construit pour les Jeux d’hiver de 1968. En 1975, la construction d’un important centre commercial (plus de 120 enseignes) apporte la touche finale au projet. Loin d’un ghetto, La Villeneuve est parfaitement reliée au centre-ville, notamment grâce au tramway.
« La mixité, sous toutes ses formes, a toujours été au coeur du développement de La Villeneuve », explique Jérôme Safar, premier adjoint au maire de Grenoble, chargé de la politique de la Ville et de la sécurité. Durant les dix premières années, les logements brassent toutes les nuances d’une gauche très militante : enseignants, travailleurs sociaux, étudiants, bourgeois en rupture de ban, catholiques sociaux, milieux ouvriers instruits… S’y ajoutent une poignée d’immigrés italiens et de réfugiés politiques chiliens, avec lesquels tout ce petit monde refait la révolution à la bibliothèque et au bistrot.
Au milieu des années 1980, arrivent les premières vagues d’immigration maghrébine et africaine suivies, plus tard, de réfugiés kosovars, irakiens, afghans, et des Roms aujourd’hui : « Grenoble a une grande tradition d’accueil », assure Jérôme Safar.
Déracinée, communautarisée, maîtrisant rarement le français, la population se paupérise rapidement, même si Alain Carignon, maire de 1983 à 1995, poursuit la politique sociale de son prédécesseur, le socialiste Hubert Dubedout, et crée le revenu social grenoblois, précurseur du RMI.
Mais l’immigration de masse casse les équilibres sociaux et sonne le glas de l’utopie. Nombre de soixante-huitards déconfits préfèrent vendre leur appartement et déménager. Une militante écologiste dit avoir vu partir ses amis un à un : « Ils n’en pouvaient plus de se faire agresser, de vivre dans les ordures et le vacarme des deux-roues. » (…)