Philippe Bihouix est ingénieur spécialiste de la finitude des ressources minières et de son étroite interaction avec la question énergétique. En 2010, il coécrit l’ouvrage « Quel futur pour les métaux ? » où il s’attaque à l’utilisation dispendieuse et inconsidérée des métaux et appelle à une économie de la sobriété.
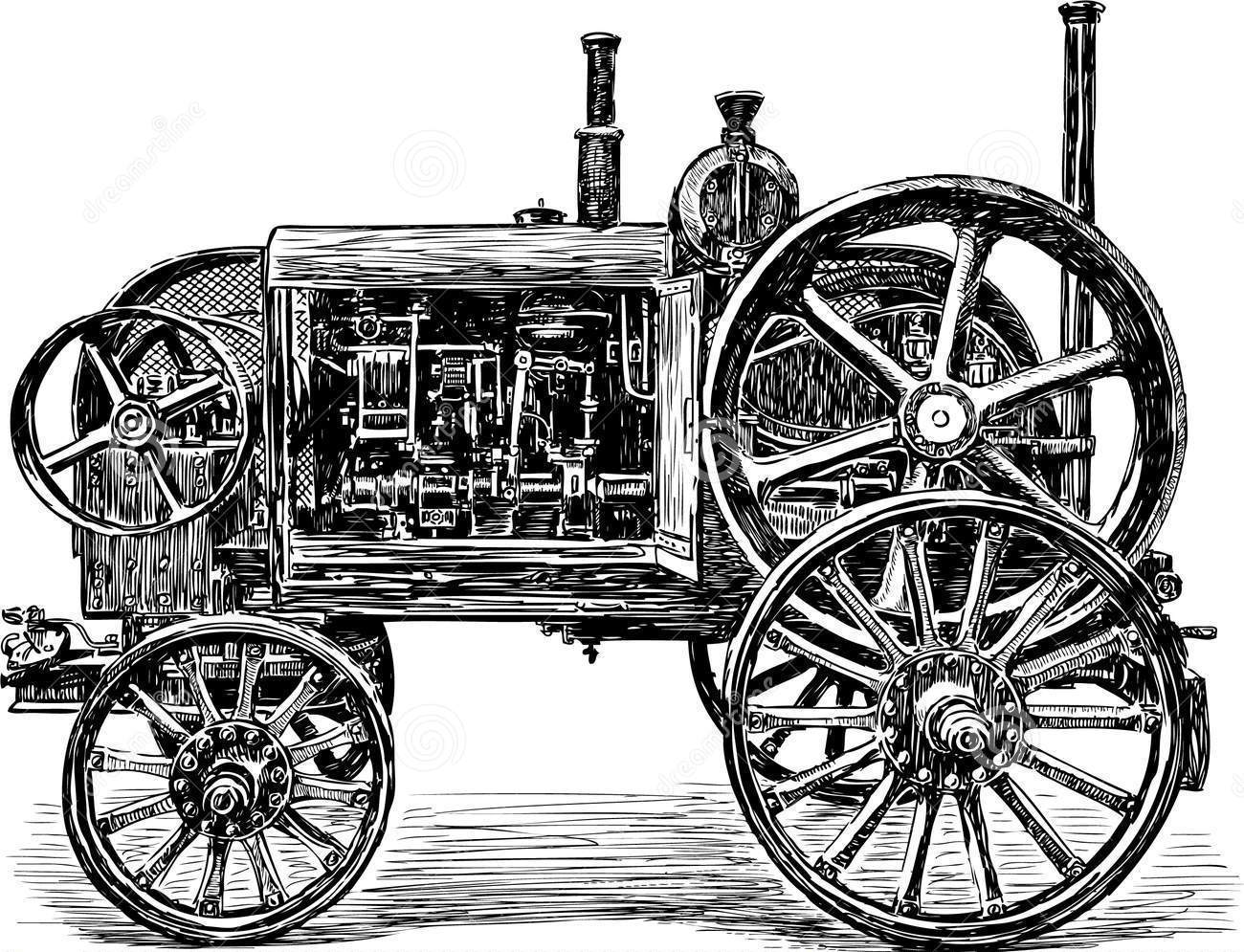 « L’Age des low-tech », son nouveau livre publié aux éditions du Seuil, reprend et élargit ce thème. L’auteur y développe un discours avant tout pratique et pragmatique, loin des idéologies et politiques.
« L’Age des low-tech », son nouveau livre publié aux éditions du Seuil, reprend et élargit ce thème. L’auteur y développe un discours avant tout pratique et pragmatique, loin des idéologies et politiques.
Son approche évite les écueils d’un discours catastrophiste sur le dérèglement climatique, brise les repères habituels et mène pas à pas le lecteur vers une conclusion simple : notre civilisation consomme plus que la planète n’a à offrir.
Croissance verte, développement durable et autres solutions high-tech sont autant d’impasses. Plutôt qu’une sortie de crise « par le haut », préférons une sortie « par le bas » qui nous épargnera bien des souffrances et désillusions.
Commençons simplement : le low-tech, c’est quoi ?
Philippe Bihouix : Pour parler des low-tech, il faut d’abord établir deux constats :
- d’une part, la consommation de ressources non renouvelables (énergie et matières premières) est insoutenable, et nous en consommons davantage chaque année ;
- d’autre part, les solutions technologiques qu’on nous propose ne sont absolument pas des solutions. Soit ces solutions sont marginales et hors d’échelle, donc pas à la hauteur du défi, soit elles reposent sur le recyclage de nos produits, « l’économie circulaire », qui ne marche que très partiellement du fait de la dégradation des matières utilisées ou de la difficulté à séparer les composants.
Face à ce double constat, le low-tech, c’est se dire : comment j’essaie de remplir au mieux les besoins, rester dans une civilisation acceptable et soutenable, malgré l’épuisement des ressources ? Low-tech veut tout dire et rien dire, c’est surtout un pied de nez au high-tech.
Donc, pour prendre un avatar de la société moderne, à quoi ressemblerait une voiture low-tech ?
La voiture propre n’existe pas, c’est un mensonge. Quand bien même l’énergie serait propre – ce qui n’est pas le cas –, l’ensemble de ce qui sert à fabriquer la voiture et qui n’est pas recyclable a un coût. Plus la voiture va vers le high-tech pour polluer un peu moins, moins la voiture est recyclable, et ses composants issus du recyclage.
L’approche low-tech, c’est une voiture beaucoup plus simple, plus légère, avec un moteur bridé, absolument aucun équipement électronique – disons le moins possible… C’est la deux-chevaux avec un filtre à particules, si j’exagère.
L’étape d’après, c’est de se passer de la voiture, de la circonscrire à quelques usages spéciaux, et d’enfourcher un vélo.
Où situeriez-vous votre livre dans le paysage écologiste ?
Il y a deux types d’écologie : celle de l’offre et celle de la demande. Dans un cas, on va réclamer la fermeture des centrales nucléaires sur la base d’un grand programme d’éolien et de solaire. Quelque chose comme : « Je ne veux pas tellement renoncer à mon confort, mais je veux que ce confort soit rempli de manière plus écologique. » D’où l’idée de croissance verte, développement durable, etc.
L’écolo de la demande réfléchit plutôt comme cela : « Pourquoi installe-t-on un parc éolien offshore au large de Saint-Nazaire alors qu’on égrène le long des rues et dans les bureaux de poste des écrans plats énergivores ? Pourquoi ne pas enfiler un pull plutôt que de faire marcher à fond les chauffages et isoler ensuite les bâtiments ? »
Partisan de la décroissance alors ?
Absolument. Je suis dans la dénonciation du développement durable et de la croissance verte, qui forment un mythe anesthésiant et sont fait pour ça. La réalité, c’est que ça ne fonctionne que partiellement ou pas. Voltaire disait :
« Le vrai me plaît, le vrai seul est durable. »
Je viens là de passer du côté des écolo-liberticides [rires]. Je préfère la décroissance choisie, intelligemment choisie, avec pourquoi pas un peu d’innovation, technique ou sociale d’ailleurs, plutôt que rester dans un scénario de statu quo qui mène tout droit à une décroissance subie, plus violente.
Vous voulez encadrer l’innovation, orienter stratégiquement la recherche, mais vous dénoncez en revanche le mythe de la « percée technologique ». La fusion par exemple ?
J’ai du mal à m’exprimer dessus, je ne suis pas un spécialiste. Mais je ne fais que constater ce que tout le monde constate : qu’on décale les programmes de vingt ans tous les vingt ans… Mais avant même la fusion, je « tue » la génération 4 des « surgénérateurs » de type Superphénix. On souffre déjà sur la génération 3 (ce qu’on essaie de faire avec l’EPR).
Le surgénérateur, c’est la centrale géniale qui consomme des déchets nucléaires et de l’uranium 238, qui apparaîtrait dans les années 2030 ou 2040 et qui nous donnerait quelques milliers d’années d’énergie.
Sauf qu’il faut changer ces centrales, renouveler le parc. Là, on a un problème métallique. Nickel, cobalt, zirconium, hafnium… On est dans un usage dispersif de ces ressources : toutes ces ressources ne sont pas recyclables car trop irradiées, on sait qu’elles vont être perdues.
Ces mêmes ressources ont une espérance de vie à l’échelle planétaire de quelques dizaines d’années, voire quelques siècles si on repousse les frontières technologiques pour les extraire : le nucléaire n’est pas soutenable à long terme.
Vous attaquez également le nucléaire sur sa dangerosité…
Le problème du nucléaire, c’est que ça ne s’arrête pas comme une usine normale. Pour démanteler, il faut de l’énergie, des gens, un « macrosystème technique » (robots, électronique, main-d’œuvre qualifiée, capacité à faire du ciment, etc.), et être certain que l’on aura accès à tout cela dans dix ans, vingt ans, cinquante ans… C’est un pari. Un pari osé.
Et quand vous allez voir le film sur le site d’enfouissement Onkalo en Finlande, les responsables vous expliquent noir sur blanc qu’il faut enterrer les déchets car le monde va devenir instable…
Pour revenir sur les énergies renouvelables, en quoi ce n’est pas soutenable ?
Je ne suis pas contre les énergies renouvelables en temps que telles. Je suis contre le mirage que les énergies renouvelables nous permettraient de continuer ainsi sans remettre en question nos besoins.
Pour être plus précis : je suis contre les énergies renouvelables en tant que macrosystème économique massivement déployé, avec une capacité nécessaire (une fois l’intermittence prise en compte) qui serait de l’ordre de trois ou quatre fois ce qu’il faut aujourd’hui en énergie fossile.
C’est le formidable mirage de Jeremy Rifkin, où nous serions tous producteurs, où des « smart grids » viendraient tout équilibrer et répartir le courant… Il y a un énorme mensonge sur le « tous producteurs, tous consommateurs ».
Si vous installez un panneau solaire sur votre toit, vous n’êtes pas producteur, vous n’êtes pas dans le secondaire. Vous fournissez un service immobilier en fournissant votre toit, et financier en fournissant en achetant les panneaux. Jamais ce macrosystème technique ne sera soutenable, et il nous emmènera d’autant plus vite dans le mur que ces « smart grids », éoliennes et autres panneaux solaires sont très demandeurs en matériaux non-renouvelables.
On ne fabrique pas une éolienne avec l’énergie d’une éolienne. On la fabrique avec beaucoup de gaz, de pétrole, de charbon, et est bourrée de composants électroniques qu’on ne sait pas recycler et qui ont une durée de vie de seulement trente ans.
Quelle(s) solution(s) en termes d’énergie alors ?
Il faut commencer par reconnaître que nous avons un gros problème : il faut définir une cible « post-transition », c’est-à-dire le niveau soutenable en termes d’énergie pour le nombre d’habitants vivant aujourd’hui sur la planète.
Et il va falloir qu’il soit bien en deçà du niveau actuel. Ce « bien en deçà » peut faire l’objet de débat. Moi, je mise sur une consommation d’énergie autour de 20 à 25% de notre consommation actuelle.
Ensuite, comment on produit ? Il peut y avoir de l’hydro-électrique. C’est déjà 15% environ de la production d’électricité (pas d’énergie) en France : ça fait déjà un bout. Après, un peu de solaire thermique, de la biomasse, des éoliennes et panneaux, mais davantage low-tech.
Comment on procède ? Il y a trois postes dans lesquels il faut tailler :
- nos déplacements pour commencer. Il faut que nos déplacements deviennent plus difficiles, qu’on se déplace moins ;
- le deuxième, c’est le bâtiment, le chauffage. Je ne dis pas qu’on doit passer à la douche froide, mais chauffer moins, revoir notre niveau de confort, accepter qu’il fasse un peu froid l’hiver ;
- troisièmement, c’est l’énergie contenue dans les objets qu’on fabrique et qu’on jette, du gobelet en plastique à l’écran plat. Là aussi on doit recycler, mais on a vu les limites de ce système. Il faut donc réintroduire les consignes, l’interdiction du produit jetable, augmenter la réparabilité de nos appareils, etc.
Même si votre discours n’est jamais politique ou politisé, on a du mal à ne pas y voir une charge contre le capitalisme. Prônez-vous un musellement ou une révolution du système ?
Il y a des raisons fondamentales qui font que le capitalisme n’est pas compatible avec tout ça. La première, c’est la question du prêt à intérêt. Je pense que ce système – interdit par ailleurs par de nombreuses civilisations dans l’Histoire – oblige mathématiquement la masse monétaire à augmenter.
L’équation de Fisher pose le postulat que si la masse monétaire augmente (à cause des intérêts) avec la même quantité de biens et de services, l’inflation croît similairement. Donc faire croître le PIB pour éviter une banqueroute implique nécessairement de faire croître la quantité de biens et services, et donc la consommation d’énergie et de matières premières.
Donc oui, il y a une remise en cause du capitalisme dans ce bouquin.
Vous proposez un principe d’exemplarité, l’idée que des prises de positions fortes et unilatérales peuvent faire bouger les choses à une échelle plus grande.
Oui, je pourrais prendre l’exemple de la révolution française. On n’a pas attendu que les royautés d’Europe s’assoient autour d’une table pour discuter des revendications du peuple et prendre une décision. Mais je préfère l’exemple de l’abolition de l’esclavage.
L’abolition de l’esclavage a démarré sur des principes moraux, mais pour une nation comme l’Angleterre, cela avait des conséquences économiques profondes. C’était certes une grande puissance, mais il n’empêche qu’à force d’exemplarité et de lobbying, on n’a pas eu à attendre une grande conférence mondiale pour décider du sort des esclaves…
Entre initiatives locales et conférences internationales, il y a certainement un créneau à trouver. Où est-il ? Le Jacobin dira que c’est l’Etat nation. Peut-être que c’est le regroupement de quelques pays liés par une « communauté de destins ». Sur les questions écologiques, je me sens finalement plus proche de la Belgique, de l’Italie ou de l’Allemagne que de la Russie, de l’Espagne ou de la Pologne.
Il y a aussi une remise en question de la construction européenne dans mon livre. Je pense que l’échelle pour la prise de décision ne peut être européenne. On est trop gros, il y a trop de monde.
Au niveau national, il y a plein d’initiatives dans l’agriculture, dans l’urbanisme et que sais-je encore qui peuvent démarrer sans qu’on se fasse casser les reins par la finance internationale.
Dans le mythe de Prométhée, la société humaine, à qui l’on venait d’offrir les arts techniques, est finalement sauvée de l’autodestruction par Hermès envoyé par Zeus pour transmettre à l’homme le sens de l’honneur et la morale. Ça vous parle ?
Mes premiers relecteurs m’ont parfois reproché de décrire un projet sans décrire comment y aller. Une sorte de « y a qu’à, faut qu’on » très moral. En fait, je l’ai pris non pas comme un reproche mais presque comme un compliment. Je ne veux pas décrire comment y aller « exactement ». Les temps ne sont pas venus pour ça, et je ne veux pas m’enfermer dans les détails techniques.
Ce que j’ai voulu faire ici, c’est donner à voir les orientations. Les solutions, on les a finalement, on voit où aller, comment y aller grosso modo. Donc oui, la morale est vitale et il y a en a un peu dans mon livre. C’est devenu un gros mot aujourd’hui.
Où êtes-vous dans les trois attitudes que vous énumérez face à la perspective d’effondrement civilisationnel : attentisme, fatalisme ou survivalisme ?
En tout cas, je ne suis pas pour le catastrophisme. On l’annonce depuis des décennies cette catastrophe, et elle n’est pas arrivée. Je pense qu’on va s’adapter aux forceps. Ce sera tous les ans plus dur, tous les ans plus moche, plus pollué, le discours sera de plus en plus éloigné de la réalité.
Le livre de Bertrand Méheust, « La Politique de l’oxymore », explique remarquablement comment plus les choses empirent, plus le discours se déconnecte la réalité, comment les sociétés allaient aller jusqu’à leur saturation, devenant de plus en plus délirantes et orwelliennes.
Plus ce sera pollué, plus on vous expliquera que les technologies vertes, c’est génial. Ça a déjà démarré. Il va falloir apprendre à partager, à s’appauvrir.
Ce ne sera donc pas tant un « écocide » brutal que du sang et des larmes ?
Exactement. Du sang et des larmes, mais sans l’espoir. C’est ce que je pense. Et le temps venu, on entendra un discours prônant la sobriété et comme c’est bien de se serrer la ceinture puisqu’il n’y aura de toute façon plus le choix.
Je suis plus gradualiste que catastrophiste, si je puis dire. Mais cela ne sert a rien de rester tétanisé. Tout ça va prendre beaucoup de temps. On va vivre, avancer.
_________________________________________________






