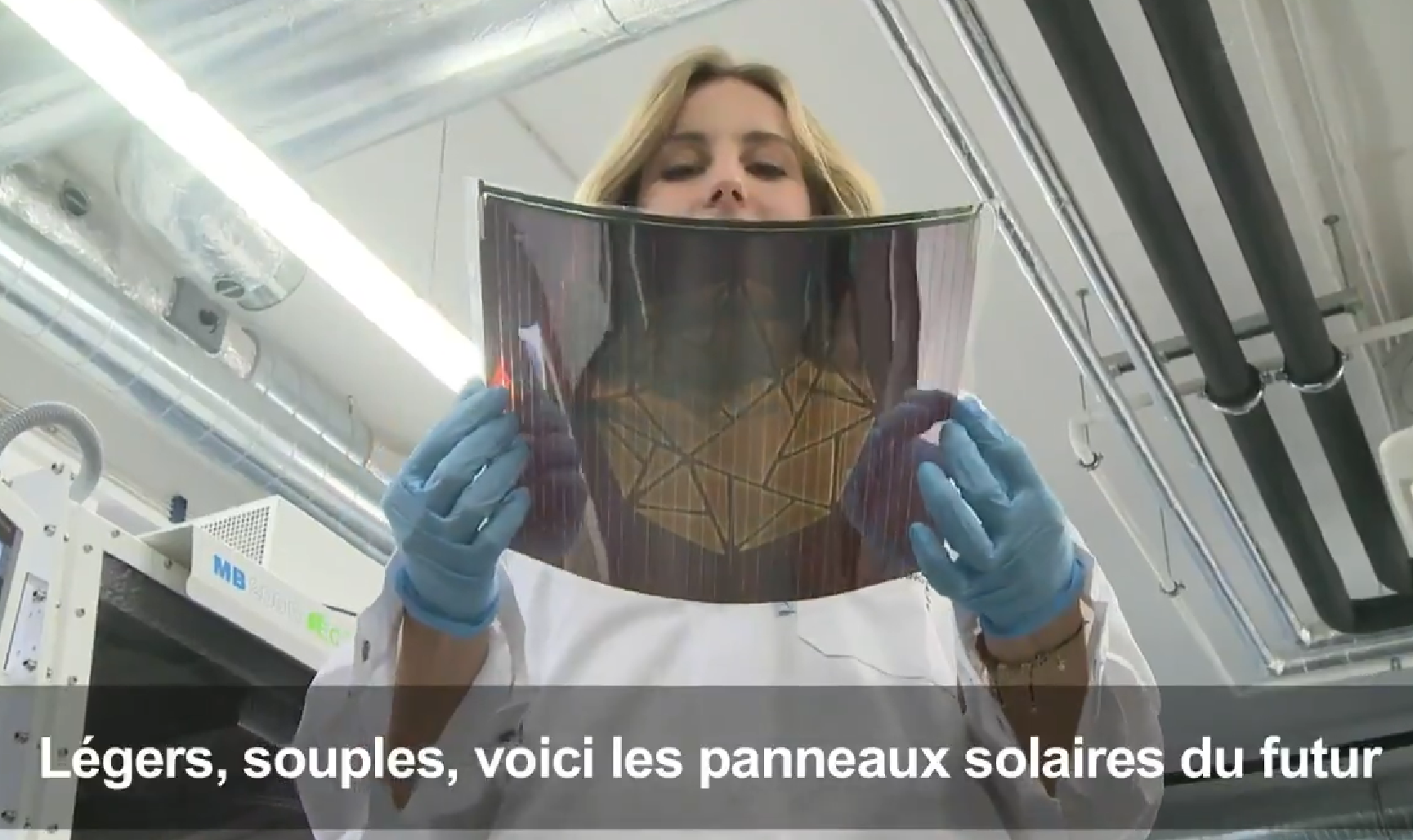Auteur du livre « Bienvenue dans le nouveau monde. Comment j’ai survécu à la coolitude des start-up », Mathilde Ramadier dénonce la précarité des emplois dans les start-up.

Dans votre livre, vous déconstruisez « la novlangue abêtissante » des start-up. Vous n’y allez pas un peu fort ?
Non. Dans les douze start-up où j’ai travaillé, je n’étais pas la seule à penser que le discours qu’on nous tenait n’était qu’une machine à produire du rêve. Derrière des jolis titres de « managers », nous étions free-lance ou stagiaires, c’est-à-dire précaires. Et nous ne changions pas le monde. Je travaillais à Berlin, mais ce modèle, celui de la Silicon Valley, se retrouve partout dans le monde. Certes, dans une start-up, on peut travailler en s’amusant. Mais une fois que l’employé est réduit à un stade régressif, c’est plus facile d’abuser et de lui demander de travailler tard le soir.
92 % des employés de start-up travaillent en CDI, à en croire une récente étude EY pour France Digitale. Peut-on parler de précarité ?
Regardez les sites d’emplois spécialisés et vous verrez que les offres concernent surtout des stages ou des contrats de free-lance. Le problème des startuppeurs, c’est qu’ils embarquent leurs équipes dans leur propre précarité. Ils rêvent d’introductions en Bourse très rapides et comptent sur des petites mains diplômées et polyglottes pour y arriver et occuper des emplois sous-qualifiés. J’ai travaillé pour un serial entrepreneur qui a fermé une start-up du jour au lendemain pour se consacrer à une autre.
Dans ce cas, pourquoi ces entreprises conservent-elles leur attractivité ?
Les employés de start-up sont jeunes. Pour beaucoup, c’est une première expérience. Ils se disent qu’il faut au moins tenir un an pour leur CV.[…]