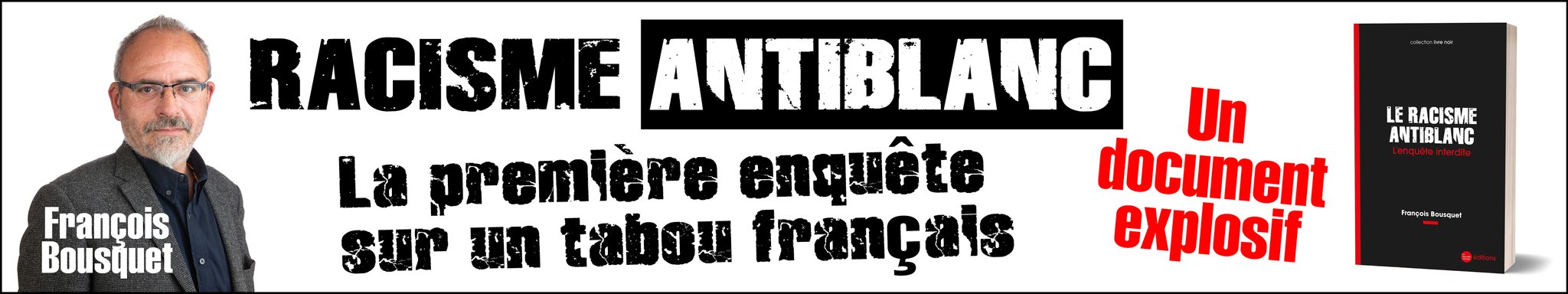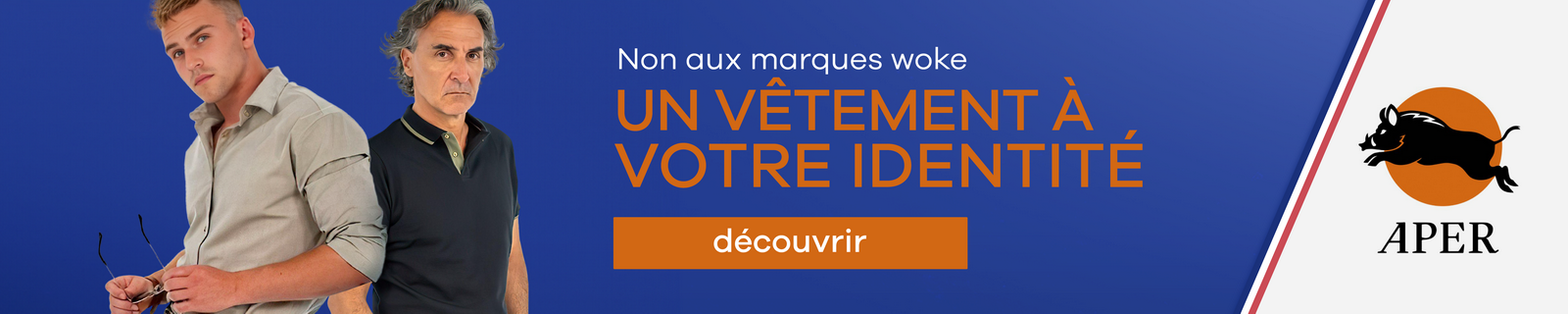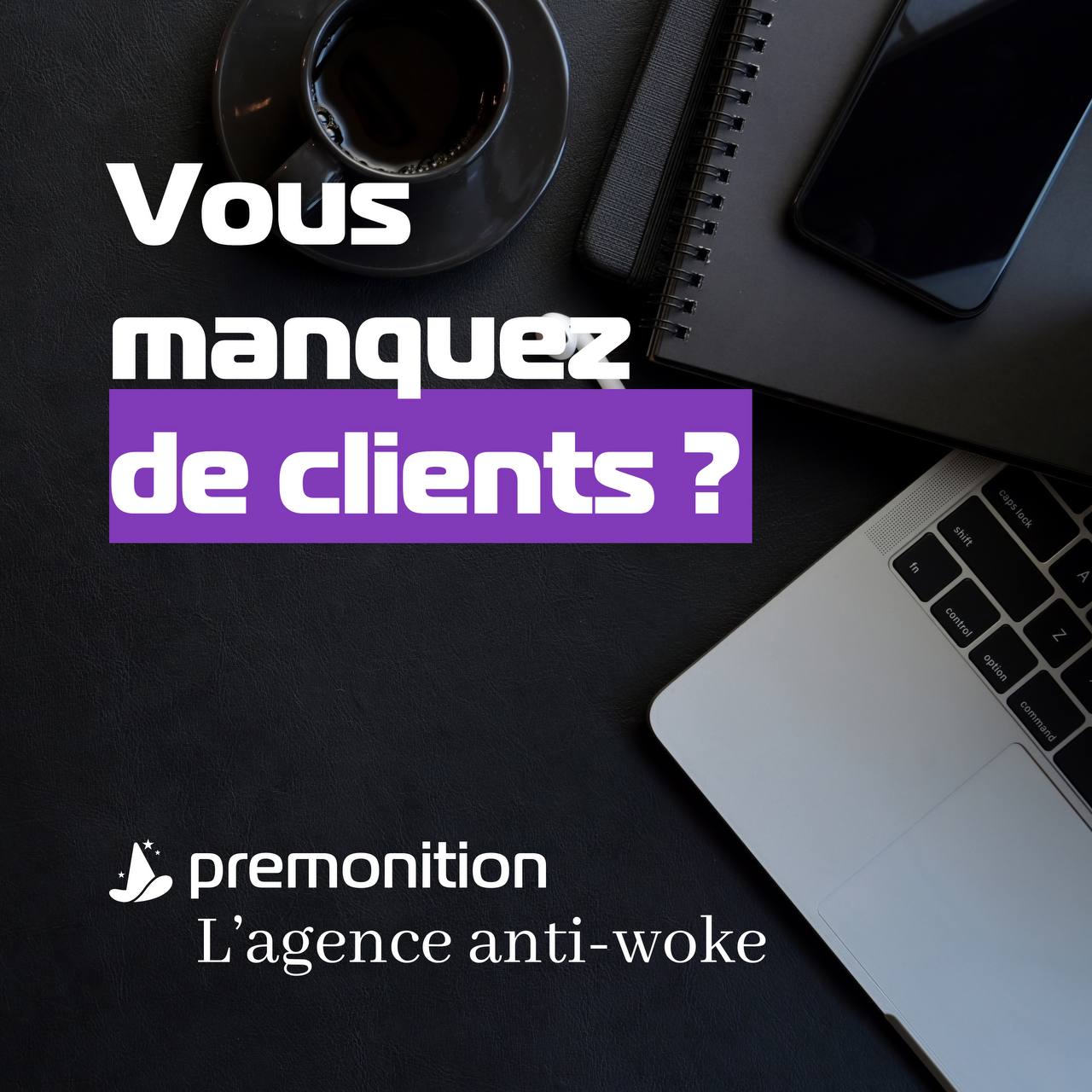Selon Le Monde, la recherche en génomique humaine est profondément biaisée par la surreprésentation des ADN d’origine européenne dans les bases de données, ce qui fausse les diagnostics médicaux, surtout pour les populations non européennes. Un exemple marquant est celui de cinq Afro-Américains à Boston, faussement diagnostiqués entre 2004 et 2014 d’une maladie cardiaque grave à cause de comparaisons avec des échantillons majoritairement européens.
Les chercheurs d’Harvard ont démontré que des variantes génétiques normales chez les Afro-Américains ont été considérées à tort comme pathologiques. Cette erreur aurait pu être évitée par une plus grande diversité dans les cohortes étudiées. Aujourd’hui, 77 % des données dans la base gnomAD proviennent d’individus européens, contre seulement 5 % d’Africains. Même constat dans les études GWAS (90 % sur des Européens) et en pharmacogénétique (64 %).
L’OMS a appelé en 2024 à corriger ces déséquilibres pour que les bénéfices de la recherche profitent équitablement à toutes les populations. Des programmes émergent (comme All of Us aux États-Unis ou H3Africa), mais l’usage massif de bases de données eurocentrées perdure.
En France, le plan “PopGen” ne concerne actuellement que des personnes ayant quatre grands-parents nés dans la même région hexagonale, excluant ainsi une large part de la diversité française. Une extension via le programme Genome of Europe est prévue, mais elle restera limitée à l’Europe. Les scientifiques dénoncent un accès inégal aux diagnostics et aux traitements, et des chercheurs appellent à des pénalités pour les projets qui négligent la représentativité génétique.